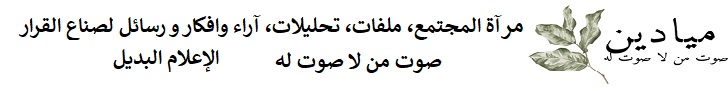Au cours des dernières années, on a vu beaucoup d’immigrés sub-sahariens employés ici et là en Tunisie, dans des garages de réparation de voitures, des stations d’essence et de lavage de voitures, des points de vente de «gasoil Lybien», etc. Absolument, plus rien de cela. Jusque-là, je n’y vois personne.
Sfax est à deux heures de route de Mahdia. La journée s’annonçant particulièrement chaude, je décide de partir tôt. Il n’est pas 8 heures quand j’aborde l’agglomération sfaxienne qui, comme d’habitude, grouille d’activités économiques diverses et variées.
Et voilà que je croise le premier adulte noir. On se salue. Il parle arabe. «Si B» est un compatriote tunisien. Très ouvert et jovial. Je lui demande comment, lui, il va. Il me répond: «moi, je vais bien. Ma famille aussi. Nous n’avons pas de problèmes. ‘Al-Hamdou Lillah’. Du moins jusqu’à maintenant. ‘Rabbi Youstor’».
De là, il enchaine: «il y avait pas mal d’Africains qui étaient employés à Sfax. Cela se passait correctement. Tout le monde trouvait son compte. Mais, les problèmes ont commencé à se manifester depuis le mois de février dernier. Un climat de peur générale s’est installé. Beaucoup de problèmes en ont résulté. Je ne vous en dis pas plus. Allez-y voir plus loin vous-même».
J’arrive à la place de Bab-El-Jebli qui est l’une des grandes places de Sfax, attenante à l’une des plus célèbres grandes portes de la vieille médina de Sfax.
Et là, je découvre un large rassemblement d’immigrés sub-sahariens et un spectacle de désolation que je n’ai jamais vu auparavant dans notre pays. Si ce n’était le côté majestueux des murailles et des bâtiments tout autour, la beauté de cette place avec ses espaces verts et les grandes avenues animées qui la traversent, je me serais cru au cœur d’un bidonville, mais certainement pas en Tunisie. Bidonville par la quantité de déchets et de détritus, par l’absence d’équipements et de services sanitaires et par la “clochardisation” apparente de nombreux immigrés.
D’après mes estimations, il devait y avoir autour d’un millier d’individus, essentiellement des hommes mais aussi des femmes, des enfants et même des bébés et des nourrissons. Ils étaient plus nombreux les jours précédents. Leur nombre a baissé en raison de la relocalisation forcée de centaines d’entre eux par les autorités qui les ont conduits et abandonnés dans le désert, à proximité de la frontière libyenne et ailleurs.
La plupart des immigrés sont groupés en grappes humaines, à l’ombre des arbres et des immeubles environnants.
Ils sont assis, accroupis ou allongés à même le sol ou sur des cartons. Certains trainent par terre.
Ironie de l’histoire, un des groupes est adossé contre le monument de la statue du Président Bourguiba. Ce dernier doit se retourner dans sa tombe en voyant sa mémoire souillée par le spectacle de désolation, de souffrances et de malheurs de ce groupe de jeunes migrants en errance.
Les autres sont assis à l’ombre des arcades des galeries marchandes toutes proches. Quelques-uns se sont joints à des mendiants tunisiens pour faire la manche à l’entrée des portes d’accès du grand marché limitrophe.
Il fait une chaleur torride. Plus de 40 degrés à l’ombre. En sueur, les piétons se pressent pour finir leurs courses. Certains ralentissent le pas pour regarder d’un peu plus près cet incroyable spectacle de déchéance humaine. Quelques-uns s’arrêtent pour discuter avec eux et d’autres pour leur mettre une pièce d’argent dans la main.
Deux fourgonnettes des forces de l’ordre sont stationnées assez loin, à l’autre bout de la place. Je suppose, ou du moins j’espère, que ces forces sont là pour intervenir en cas de nouveaux actes de violence contre ces immigrés.
Plus près de cette masse humaine se trouvent trois agents de sécurité qui m’ont vu venir stationner ma voiture du côté des immigrés. Mon coffre arrière est chargé de bouteilles d’eau, de bouteilles de lait et de pots de yaourt que je destinais à ces pauvres immigrés.
Au moment où je commence à ouvrir le coffre, des agents la police municipale m’interpellent. «Qu’est-ce que vous faites là? Qu’allez-vous faire?», «Distribuer quelques vivres à ces pauvres gens», «Vous travaillez pour une association? Laquelle?». Surpris et excédé par leurs questions, je leur réponds sèchement: «Non! Je suis tout simplement un Tunisien comme vous». Ils partent.
A peine ai-je ouvert le coffre de la voiture que des dizaines de ces jeunes malheureux accourent de partout et se ruent sur moi. Tout d’un coup, une cohue humaine invraisemblable se constitue autour de moi. Je suis dépassé et franchement bouleversé.
Dans cette bousculade générale, je ne vois plus que des bras et des mains se tendre pour capter la première bouteille ou le premier paquet venu. Il n’y a plus aucun doute pour moi. Ces pauvres gens souffrent de la soif et de la faim. Les vivres entassés dans mon coffre se sont évaporés en quelques minutes.
La tâche était tellement dure que j’ai décidé de faire appel au service de deux jeunes tunisiens qui trainaient dans les alentours, pour m’aider à distribuer deux autres convois de vivres achetés dans un supermarché proche. Même scénario. Même spectacle de désolation et de misère humaine.
Ensuite, j’ai consacré le reste de mon temps à parler avec eux, à les écouter. Nombreux sont ceux qui se sont approchés de moi pour me parler de leur histoire, me raconter ce qui leur était arrivé, me décrire l’état de misère dans lequel ils se trouvent et ce qu’ils pensent de leur avenir.
Ils étaient unanimes pour dire qu’ils avaient quitté leur pays pour fuir la pauvreté, la misère, la faim, les assassinats politiques et religieux, les conflits tribaux, les règlements de compte, les réseaux mafieux et les guerres. La plupart sont arrivés de Guinée-Conakry, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et de la Côte d’Ivoire. Des pays où j’ai eu la chance de travailler et voyager.
La plupart d’entre eux sont venus par voie de terre. Ils traversent le Mali ou le Niger, rentrent en Libye ou en Algérie avant d’aboutir en Tunisie. Aux frontières de chaque pays, ils ont affaire à des «réseaux de passeurs» organisés qui, selon le cas, leur demandent des sommes faramineuses pouvant dépasser les 1500 Euros par tête.
Ils m’ont déclaré qu’une fois en Tunisie, ceux qui trouvent un travail stable tendent à rester, avec l’espoir d’y faire une vie. Les autres font des petits boulots, afin d’amasser suffisamment d’argent pour payer les passeurs qui les aideront à prendre un jour un bateau vers l’Italie.
Ils me disent tous que les problèmes ont surgi brutalement au mois de février, suite au discours du président sur les dangers de l’immigration pour la Tunisie. Tous ont alors été brusquement congédiés par leurs employeurs et depuis, ils ne trouvent pas de petits boulots de remplacement. Ils n’ont plus de ressources, ils n’ont plus d’argent pour vivre.
Pire encore, ils ont été expulsés des logements qu’ils louaient. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain dans la rue.
Le fait le plus marquant est qu’ils affirment que les autorités ont longtemps fermé les yeux sur le sort qui leur était réservé. Selon eux, pendant tout ce temps, les autorités ont fait très peu pour venir à leur secours et intervenir pour mettre fin à toutes ces exactions, et surtout en empêcher de nouvelles. Ils assurent aussi que les autorités n’ont que rarement donné suite à leurs cris d’alarme et aux plaintes qu’ils leur ont soumises.
Les exactions violentes ont malheureusement atteint leur paroxysme les jours qui ont suivi le terrible assassinat, le 3 Juin dernier, d’un compatriote Tunisien par une bande de trois ou quatre immigrés.
La seule solution pour se protéger de ces violences, m’ont-ils expliqué, était de ne plus demeurer éparpillés mais de venir se rassembler au centre-ville. Là, ils se sentent malgré tout, plus en sécurité du fait de la présence d’un grand nombre de Tunisiens qui vivent, travaillent ou circulent dans les alentours.
En sécurité, oui, peut-être, mais les conditions dans lesquelles vivent ces pauvres gens sont absolument inacceptables dans tout état de droit qui se respecte, avec de surcroît dans un pays comme le nôtre, connu pour avoir une population accueillante.
L’un des immigrés présents y a d’ailleurs fait référence en me disant: «Vous avez accueilli sans aucun problème, des millions de libyens qui sont venus se réfugier chez vous fuyant leur guerre civile là-bas. Nous ne sommes que quelques centaines. Pourquoi vous nous traitez comme ça?».
Et c’est à ce point précis que quelqu’un d’autre se précipite pour tendre son bras et le mettre à côté du mien en me disant: «tu vois, je suis noir, mais j’ai la même couleur de peau que toi. Nous sommes pareils, non? Pourquoi, les arabes, comme toi, nous ont fait tant de mal?».
Le cercle de discussions s’élargit davantage. Le débat met l’accent maintenant sur leur peur de l’avenir et sur les risques et les défis qui les attendent. Et là, pour une raison que j’ignore, ils ne s’adressent plus à moi. Ils lèvent la voix pour lancer des appels «Au Président et au Peuple Tunisien».
Leur premier appel est un cri de détresse: «Nous demandons au Président et au Peuple Tunisien de mieux nous traiter, de nous protéger des violences et du racisme et de nous assurer les conditions minimales pour subsister ici, le temps que nous quittons votre pays.»
Le deuxième appel insistant est: «Nous demandons au Président et au Peuple Tunisien. S’il vous plait, ne nous transportez pas dans le désert, comme vous l’avez fait avec les autres ces derniers jours. Ne nous renvoyez pas non plus dans les pays d’où nous venons ni dans ceux que nous avons traversés pour venir jusque chez vous. Nous ne voulons pas être renvoyés ni en Lybie ni en Algérie».
Et voilà que quelqu’un hausse la voix pour dire: «Nous avons bien compris que vous ne voulez plus de nous ici. Nous voulons dire au Président et au Peuple Tunisien que nous n’avons rien contre cela. Nous sommes disposés à libérer votre pays de notre présence. La seule petite faveur que nous vous demandons est de nous laisser prendre «la route de l’eau (sic)».
«Vous verrez en une semaine, vous ne verrez plus aucun de nous en Tunisie. Laissez-nous prendre «la route de l’eau». Après, ne vous inquiétez pas pour nous. Après, c’est notre affaire. Notre vie est aux mains d’Allah».
Prendre «la route de l’eau» c’est pour tous ceux à qui j’ai parlé prendre un bateau pour l’Italie. Le rêve de toute cette population subsaharienne de la Place Bab El-Jebli est de quitter la Tunisie pour gagner l’Europe, retrouver un gagne-pain et un peu de dignité.
Cette journée à Sfax m’a profondément affecté. Dans tous mes voyages à travers le Monde, notamment en Afrique subsaharienne, j’ai rarement été confronté à une telle déchéance humaine. J’ai honte d’avoir vécu cela dans mon propre pays, cette Tunisie d’ordinaire si accueillante.
Il faut reconnaitre que le problème est complexe, mais je me permets d’insister sur le fait qu’il n’est pas inextricable. Nous avons suffisamment de forces vives, d’intelligence, de compassion et d’ouverture sur le monde en Tunisie pour qu’ensemble, nous trouvions les solutions appropriées et les traduire en actes tangibles.
En attendant, nous n’avons pas d’autre choix que de traiter avec respect ces immigrés Africains qu’ils soient rassemblés à Bab-El-Jebli, à Sfax ou éparpillés ailleurs à travers la Tunisie.
En attendant, nous nous devons de leur redonner une dignité. Et ce, en commençant par de simples mesures d’urgence: en ne les laissant pas vivre dans la saleté, la faim et la soif, en leur offrant des abris, un accès à des points d’eau potable et de services sanitaires, en leur distribuant des repas et en leur fournissant des soins médicaux.
La Tunisie, La grande Tunisie de Bourguiba, se doit et peut faire mieux.

Par Salah Darghouth – Leaders.com




 World Opinions Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média
World Opinions Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média