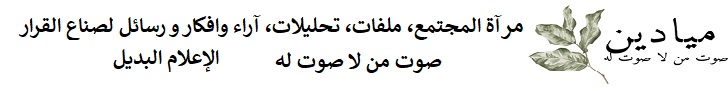« Si les électeurs turcs arrivent à déloger Erdogan de son palais présidentiel, c’est un tournant géopolitique majeur », veut croire l’ancienne ministre espagnole des affaires étrangères, Arancha Gonzalez, doyenne de l’Ecole des affaires internationales de Sciences Po à Paris.
La mise en scène aurait pu être plus percutante encore si les deux protagonistes du jour avaient pu se rendre sur place, à Akkuyu, dans le sud de la Turquie sur les bords de la Méditerranée : les présidents Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont inauguré ensemble, à distance, jeudi 27 avril, la première centrale nucléaire turque construite avec le soutien financier et la technologie russes. Tandis que le maître du Kremlin avait évité de faire le voyage, en pleine guerre en Ukraine, son homologue turc est lui aussi intervenu de loin, en raison des troubles intestinaux qui l’ont obligé à interrompre brièvement sa campagne en vue des élections présidentielle et législatives du 14 mai.
Il n’empêche, l’apparition virtuelle des deux autocrates au beau milieu des débats électoraux, alors que les réacteurs de la centrale sont encore loin d’être opérationnels, donne une idée des enjeux géopolitiques du scrutin.
« Une victoire d’Erdogan serait une victoire pour Poutine », considère Marc Pierini, chercheur associé à Carnegie Europe et ancien ambassadeur de l’Union européenne (UE) à Ankara. A contrario, la défaite du président sortant face au chef de file de l’opposition, Kemal Kiliçdaroglu, ferait les affaires des Occidentaux, à commencer par celles des Européens. A Bruxelles, Paris ou Berlin, comme à Washington, la discrétion est de mise afin de ne pas susciter la colère du dirigeant sortant en interférant dans la joute électorale.
Cependant, l’hypothèse d’une alternance à Ankara, longtemps illusoire, est désormais prise au sérieux, voire secrètement souhaitée, en dépit de doutes persistants sur la bonne tenue du scrutin, ainsi que sur la réaction du dirigeant islamo-conservateur en cas de revers dans les urnes. La crise économique, la gestion chaotique du récent tremblement de terre dans le sud-est du pays et la lassitude d’une partie de l’électorat envers un pouvoir de plus en plus autoritaire donnent espoir à la coalition d’opposition conduite par le leader du Parti républicain du peuple (CHP, kémaliste).
« Si les électeurs turcs arrivent à déloger Erdogan de son palais présidentiel, c’est un tournant géopolitique majeur », veut croire l’ancienne ministre espagnole des affaires étrangères, Arancha Gonzalez, doyenne de l’Ecole des affaires internationales de Sciences Po à Paris.
S’il n’entend pas sacrifier les liens économiques avec la Russie ni renoncer à la centrale d’Akkuyu, Kemal Kiliçdaroglu se dit soucieux de « normaliser » ses relations avec ses partenaires occidentaux. La promesse pourrait aller de soi pour tout dirigeant d’un pays membre de l’OTAN et candidat à l’UE, engagé dans de laborieuses négociations d’adhésion – suspendues depuis 2018. Elle n’a pourtant rien d’une évidence après la double décennie au pouvoir d’Erdogan, tant ce dernier a mis à l’épreuve les relations avec ses homologues occidentaux, allant jusqu’à qualifier l’ex-chancelière allemande Angela Merkel de « nazie », ou à s’interroger sur la « santé mentale » d’Emmanuel Macron.

L’hypothèse d’une alternance à Ankara, longtemps illusoire, est désormais prise au sérieux par les Occidentaux, explique, dans sa chronique, Philippe Ricard, journaliste au « Monde ».




 World Opinion | Alternative Média Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média
World Opinion | Alternative Média Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média